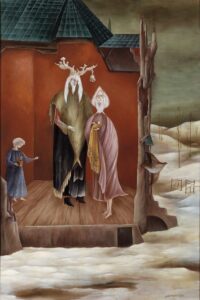Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin continue d’explorer l’histoire en présentant les œuvres de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert soixante-quinze années de conflits internationaux entre 1936 et 2011 :
Lee Miller (1907-1977), Gerda Taro (1910-1937), Catherine Leroy (1944-2006),
Christine Spengler (née en 1945), Françoise Demulder (1947-2008), Susan Meiselas (née en 1948), Carolyn Cole (née en 1961) et
Anja Niedringhaus (1965-2014).
Une centaine de documents, plus de quatre-vingt photographies et une douzaine de journaux et de magazines originaux montrent l’implication des femmes dans tous les conflits, qu’elles soient combattantes, victimes ou témoins.
UN REGARD DIFFÉRENT
Chacune de ces huit femmes photographes de guerre a son propre style graphique et narratif. La spécificité des femmes par rapport à leurs collègues masculins, tient à leur plus grande facilité à s’approcher des populations civiles. Leurs images témoignent autant des violences des combats que des souffrances des victimes. Elles montrent aussi les femmes combattantes, rompant ainsi avec les clichés habituels. Lorsqu’elles ont accès aux familles, elles réalisent des portraits extrêmement émouvants.
Cependant, tout comme n’importe quel homme photographe, elles sont sur le front et souvent en première ligne, pour témoigner des atrocités des guerres et des évènements. Certaines, comme la jeune Gerda Taro, décédée à 27 ans, y laissent leur vie…
DES QUESTIONS CLÉ
Ces photographes, dont les œuvres vont des conflits européens des années 1930 et 1940 aux guerres internationales les plus récentes, font appel à une grande variété stylistique et narrative. Leurs approches alternent entre le maintien d’une distance objective, le constat et l’implication personnelle. Parmi les photographies, on trouve des aperçus intimes de la vie quotidienne pendant la guerre autant que les témoignages d’atrocités ou des références à l’absurdité de la guerre et à ses conséquences.
L’IMAGE ET SA DIFFUSION
Le recadrage de la photographie et sa mise en scène pour l’adapter aux besoins de la presse est un point sur lequel l’exposition interpelle aussi. Chaque photographe témoigne des souffrances engendrées par les conflits avec son style particulier. Leur production doit tenir compte des réalités économiques. Employées par des agences ou des titres de presse, elles doivent fournir des images « publiables », obéissant à des critères en vigueur au moment où elles réalisent les clichés.
Toutes ces photographes souhaitent communiquer la réalité des champs de bataille et de l’arrière du front.
L’exposition passionnante et très émouvante (certaines images sont dures pour les âmes sensibles) permet de comprendre la façon dont les images prises sur le vif sont traitées par la presse.
Toutes les photographies exposées mettent le regardeur face au destin des individus en guerre et face à l’histoire. Elles parlent de conflits proches et lointains, dont certains semblent ne jamais finir.
Ici, on comprend « le bruit et la fureur » du monde.